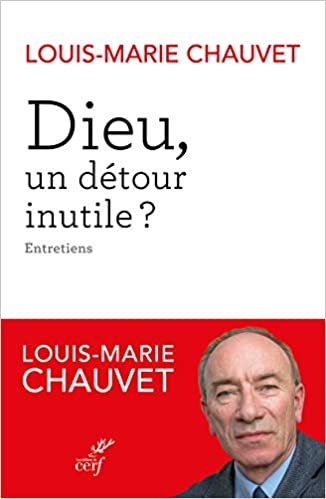
Louis-Marie Chauvet, Dieu, un détour inutile ? Entretiens. (Paris, Les Éditions du Cerf, 2020)
Il s’agit d’entretiens avec un ancien professeur éminent de l’Institut Catholique de Paris, par ailleurs curé de paroisse dans la région parisienne. Ceux-ci, annoncés comme « sans préjugés et sans concessions », ne forment pas un véritable dialogue tant les questions ne font que servir les propos de l’auteur, allant toujours dans son sens, comme celles de disciples à leur maître. Louis-Marie Chauvet est l’auteur de nombreux livres, le plus important étant Symbole et sacrement. Une relecture sacramentelle de l’existence chrétienne (Paris, Les Éditions du Cerf, 1987), et plusieurs ouvrages et articles, la plupart en langues étrangères, ont été consacrés à son œuvre et à sa pensée retentissantes. Ce livre comporte une dimension autobiographique que nous n’aborderons pas (liée notamment à Vatican II et à mai 68), en choisissant de rester au niveau des idées défendues et développées et non à celui de la personne, certainement par ailleurs très bonne et respectable. Le ton employé est assez professoral, avec souvent des affirmations fortes et arrêtées, voire quelque peu péremptoires. Au lieu de dire que ce qu’il exprime est une vision personnelle des choses et une recherche « expérimentale », l’auteur prétend exposer la doctrine de l’Église et l’engager par son discours spéculatif. Par ailleurs, la présentation qui est faite de sa personne en quatrième de couverture manque pour le moins de modestie : « prêtre engagé sur tous les fronts », « l’un des derniers grands théologiens de l’après-Vatican II », « le témoin essentiel du catholicisme français nous donne une leçon d’intelligence, de lucidité et de courage ». Rien de moins…
Quelle conception de la théologie catholique est-elle donc exprimée ici ? Nous pouvons tout de suite dire qu’on y trouve un certain rejet des formes traditionnelles d’agir et de penser dans l’Église. Le P. Chauvet insiste sur la « complexité » du Christianisme par rapport à d’autres religions, ce qui ne nous paraît pas si évident que ça :
« Une telle complexité n’a-t-elle pas conduit certains à « simplifier » ?
Si le christianisme est une religion si complexe, c’est sans doute parce que, au fond, c’est la religion du paradoxe, la religion de l’« écart », et même « du grand écart ». C’est si inconfortable que la tentation de simplifier a toujours été présente, comme le montrent les multiples hérésies tout au long de l’histoire […]. Or le christianisme n’est en bonne santé que s’il vit dans l’inconfort même de cet écart. Alors, c’est vrai, transmettre en mots simples une religion aussi complexe, c’est un défi… » (p. 66).
Une complexité certainement de nombreux et savants débats théologiques, souvent plus ou moins inutiles par rapport à l’essentiel, mais pas du message du Christ ni de la foi du Chrétien. Jésus au milieu des docteurs de la Loi, Jésus nous demandant de redevenir comme des petits enfants… En tout cas, nous ne parlerons pas de « mots simples » pour qualifier le langage employé dans cet ouvrage, à la lecture parfois difficile pour un simple croyant. L’hérésie évoquée est un choix, un mauvais choix, pas forcément une simplification. On pourrait aussi parler de l’hérésie « moderniste » dans l’Église, qui souvent ne paraît pas être « en bonne santé » en ce moment.
Pour l’auteur, cette dernière ne semble pas s’être encore assez « ouverte » au monde moderne et même post-moderne (comme il le dit), comme recroquevillée sur des acquis du passé qui seraient en décalage avec l’actualité immédiate à laquelle il faudrait en quelque sorte coller. Mais cette « adéquation », cette adaptation ou aggiornamento, à laquelle il tend est-elle vraiment possible et n’est-elle pas en fait plutôt une « prostitution » et une « idolâtrie » ? Il affirme ainsi que « cette culture n’est pas l’ennemie de la foi » (p. 12) – mais quelle culture et quelle foi ? – et parle de « la nécessité de « ré-inculturer » l’Évangile dans notre société » (p. 50). Faut-il vraiment adapter l’Évangile à nos sociétés ou plutôt nos sociétés à l’Évangile ? En fait, et malgré les quelques précautions oratoires prises, il ne peut s’agir en réalité que d’une malheureuse sécularisation du sacré, où la théologie de la grâce demande elle-même à être « réévaluée » :
« Alors, « être en état de grâce », « avoir la grâce », « gagner des grâces », toutes ces expressions, si courantes autrefois, demandent à être réévaluées. En tout cas, c’est bien autour de ce genre de problème qu’a tourné ma propre recherche théologique à propos des sacrements. » (p. 293).
Le vieux catéchisme serait donc de fait dépassé, car il s’agit désormais de penser et de parler « autrement » :
« On était encore bien loin de la définition que nous avons apprise au catéchisme ! Mais pourquoi n’évoquait-on même pas le rapport, dont vous venez de nous parler, du sacrement avec la Parole ?
On n’était sûrement pas plus bête ni moins chrétien autrefois. Mais sans doute ne pouvait-on pas penser comme on le fait aujourd’hui, tant était différent l’état de la culture. Pour moi, c’est cette évolution culturelle qui me permet et même me pousse à parler autrement. Pourtant, cet autrement rejoint du très ancien. » (p. 171).
Faisant l’éloge des écrits du philosophe et historien Marcel Gauchet (« je n’ai jamais lu quelque chose de plus limpide sur l’Église », sic !), le P. Chauvet a une conception bien curieuse du magistère et parle même du « dogme au service de l’autonomie des consciences ! » (p. 144-146). Par ailleurs, pour lui, la tour de Babel ne semble pas une catastrophe puisque « ce qui apparaît dans notre récit comme le fruit d’une malédiction de la part de Dieu est en fait une bénédiction » (p. 141).
A ses yeux le Chrétien ne peut exister que comme membre actif d’une communauté, et notamment de la communauté paroissiale à laquelle tout est ramené. Certes, la communion fraternelle est évidemment importante, mais ne doit pas s’opposer non plus, dans son horizontalisme, au dialogue filial dans le tête-à-tête vertical de la prière du croyant avec son Créateur. Tout semble réduit au souci de mission « pastorale » dans le monde actuel au détriment concrètement du salut des âmes et du secret des cœurs. Tout se rapporte à la célébration publique du peuple croyant (bien qu’il s’oppose par exemple aux grandes processions de rues…). Il affirme aussi que « l’Église croit comme elle célèbre » (p. 169) : si l’on se rend dans de nombreuses paroisses, aux messes souvent « originales » et quelque peu désertées, il faut reconnaître que l’Église croit bien mal de nos jours !
D’une manière générale, l’auteur semble hostile à toute idée de tradition qu’il assimile quelque part à un « fondamentalisme », à un repli sur soi, à une fermeture. Alors même qu’il prône une certaine diversité dans la pratique religieuse, il ne comprend pas que l’on puisse être attaché à la messe de saint Pie V ou au catéchisme du Concile de Trente. Étrangement, il se reconnaît aussi proche de Luther - étant théologien catholique nous le rappelons - dans la mise en avant dans la messe de la liturgie de la Parole, quelque peu au détriment du Sacrifice lui-même :
« Les Réformateurs croyaient aux sacrements. […] Mais ce qu’il [Luther] a voulu faire, c’est bien remettre en valeur la Parole de Dieu. Vue d’aujourd’hui, on comprend sans difficulté sa protestation. Mais le fait de vouloir remettre en valeur cette Parole ne fait pas de vous un protestant, cela fait de vous un « catholique de Vatican II », tout simplement ; mieux : un catholique « traditionnel », ce qui n’a rien à voir avec le « traditionalisme », puisque la messe de saint Pie V en 1570, invoquée par les traditionalistes, est beaucoup moins « traditionnelle » que celle de Vatican II. » [sic !] (p. 179) ;
« C’est là que le traditionalisme religieux, nostalgique du passé, est condamné en soi…
Évidemment ! On baigne alors dans la léthargie d’un passé de rêve. Ah ! « la messe de toujours ! » C’est en fait, celle de saint Pie V, après le concile de Trente, au XVIe siècle ! En ce qui concerne sa forme (la langue latine, les multiples gestes, les vêtements du prêtre, etc.), elle n’avait pas grand-chose à voir avec ce que l’on connaissait dans les premiers siècles. » (p. 208-209).
Il serait facile de réfuter plusieurs de ces arguments théologiques et affirmations historiques… Face aux « révolutions » liturgiques actuelles, qui déroutent plus le peuple chrétien qu’elles ne l’élèvent, l’auteur subordonne la théologie aux sacrements pratiqués aujourd’hui :
« Je l’ai déjà dit et montré à plusieurs reprises depuis le début de nos entretiens, on ne peut comprendre les sacrements qu’en regardant la manière dont l’Église les fait : toujours la fameuse lex orandi, lex credendi. La liturgie, je ne crains pas de le répéter, n’est pas le fruit d’une pensée théologique préalable, c’est au contraire la charge de la théologie que de clarifier conceptuellement ce qui est déjà impliqué et vécu dans la liturgie.
J’observe cependant que la tendance, même parfois au plus haut niveau, est assez souvent de redonner à la théologie la priorité. » (p. 201).
Concrètement, cela voudrait dire par exemple qu’il faudrait élaborer une nouvelle théologie pour expliquer pourquoi le prêtre doit désormais célébrer la messe le dos tourné au Seigneur, comme animateur de cérémonie conviviale… Au rejet de la tradition interne répond logiquement le recours à des concepts idéologiques contemporains externes (même si certains commencent déjà à dater comme le reconnait l’auteur pour ce qui est de la psychanalyse…), pour expliquer la foi traditionnelle de l’Église avec de nouveaux mots qui lui sont totalement étrangers. Quel intérêt spirituel peut donc bien résider dans le fait de remplacer le langage de la scolastique par celui de la linguistique par exemple ? Le P. Chauvet loue ainsi « les apports des philosophies contemporaines » (p. 261), c’est-à-dire le « passage par les sciences humaines » : sociologie, linguistique, psychanalyse, psychologie des religions, science historique, etc. (que des gros mots pour nous…). Il semble personnellement avoir été très « marqué » par la psychanalyse et la philosophie du langage, ce qui revient à plusieurs reprises au cours de l’ouvrage. Ce « passage » ressemble plus à nos yeux à une descente aux enfers qu’à un crible de purification nécessaire.
Voici un exemple de ce charabia psychanalytique au sujet de la confession :
« La culpabilité mortifère, la voilà bien celle que les notions freudiennes d’« inconscient » et de « surmoi » ont essayé d’élucider. C’est d’abord au psychanalyste que ces personnes devraient s’adresser. Mais comme prêtre je me dis que Dieu, à travers moi, les accueille jusque dans leur incapacité structurelle à gérer leur culpabilité. » (p. 282).
Nous avons été particulièrement surpris par la remise en question systématique des sacrements, qui apparemment pour l’auteur et son « progressisme évolutionniste » étaient fort mal compris et donc vécus autrefois. Nous remarquons aussi la pauvreté de sa définition du symbole[1], distingué du signe (p. 67 et suivantes), qui ne semble servir qu’à représenter et même « re-présenter », avec donc un signifiant qui l’emporte sur le signifié, quant il n’apparaît pas carrément « insignifiant » et sans signifié, dépourvu apparemment de dimension universelle et d’explication possible :
« Je voudrais d’abord rappeler que dans la liturgie, tout ce qu’on fait est symbolique. Qu’est-ce qu’un symbole ? J’en vois deux caractéristiques majeures (mais on peut en ajouter d’autres). D’abord, un symbole, cela représente. Plus précisément, cela représente un « monde », celui de mon enfance, ou celui du Moyen Âge, ou celui des Chinois, ou celui des cathos, etc. Ensuite, cette représentation se fait le plus souvent avec très peu. […]
Ainsi en va-t-il presque constamment en liturgie. […]
Oui, bien sûr, mais c’est second. Avant d’établir une relation, le symbole « re-présente ». […]
Mais revenons à la liturgie, puisqu’elle est essentiellement faite de symboles. Personnellement, j’explique assez souvent non pas les symboles eux-mêmes, car expliquer un symbole, c’est manifester qu’il ne fonctionne pas, ou mal, mais le fait que ce que fait l’Église dans une liturgie de baptême ou d’eucharistie, ce ne sont que des symboles : un peu d’eau, un peu de lumière, quelques déplacements dans l’église, quelques gestes, etc., mais qu’avec bien peu on peut exprimer beaucoup et engager gros. » (p. 67-71).
En fin de compte on peut se demander à quoi la théologie catholique, ainsi « déconstruite » et quelque peu protestantisée, réduite à son squelette « structurel » et vidée de son contenu pour en accueillir d’autres, peut encore servir de nos jours. Sur quoi peut bien déboucher de faire ainsi « table rase » du passé et annoncer d’une certaine manière la « mort de Dieu » (à la manière de Nietzsche ?), du moins d’un Dieu conceptuel ramené à une simple idole ? Dans cette optique, l’auteur, commentant la révélation à Élie sur l’Horeb dans la « voix de silence subtil » (oui de silence !), privilégie l’ouïe au détriment de la vue, alors que la vision béatifique, par les cœurs purifiés, de la Face du Dieu Vivant a toujours été considérée comme la fin ultime du désir religieux (« comme le cerf soupire après les sources d’eaux… ») :
« […] la Bible est une religion de la parole et de l’écoute, pas une religion du voir. Le VOIR, comme le montre la phénoménologie contemporaine est captateur parce que, sous le regard, les choses se figent. […] Donc Dieu est dans l’écoute et moins dans le voir, parce que le voir favorise l’idolâtrie, puisqu’il fige. » (p. 166).
Non, le regard contemplatif chrétien n’est pas celui « pétrifiant » de Méduse… Restons donc alors aveugles, du moment que nous écoutions la bonne parole professée… Dans l’épilogue, le P. Chauvet essaie d’expliquer le titre quelque peu provocateur de son ouvrage, que l’on aurait pu à la rigueur comprendre à la manière de Maître Eckhart faisant la différence entre Dieu accessible car révélé et la Déité inaccessible pour nous sur terre de notre vivant. Mais ce n’est pas le cas : une théologie trop humaine et cérébrale sans le Dieu que nous connaissons et sans la foi qui nous sauve (« va, ta foi t’a sauvé ») comme croyants, une religion parmi d’autres pouvant éventuellement être utile à l’humanité. C’est de la sorte qu’il écrit :
« Ma première affirmation est liée à ce que si le christianisme, comme toute religion, a de multiples utilités, notamment d’ordre psychique (assurance par rapport à l’au-delà, gestion de la culpabilité) et d’ordre social (régulation des mœurs, festivité, etc.), Dieu, en revanche, fait office d’idole dès qu’on prétend se servir de lui pour cautionner une vision du monde, légitimer un ordre politique, garantir une bonne conscience. Comme l’a si bien écrit Marion Muller-Collard dans L’Autre Dieu, il n’y a pas d’« enclos » pour Job. Sa foi en Dieu et ses efforts pour bien agir ne l’ont protégé de rien. Il faut bien reconnaître que défaire ainsi l’idole, faire le deuil d’un Dieu dont nous pourrions nous servir demande une conversion jamais achevée parce qu’elle touche à la racine même de notre désir… » (p. 319).
Dans une telle perspective - qui pose de fait la question de la sainteté d’un saint Louis, d’une sainte Jeanne d’Arc ou d’un saint Pie V pour ne prendre que trois exemples, pourquoi ne pas aller même jusqu’à assimiler Jésus qui apparaît ressuscité à Marie-Madeleine comme « l’obscur objet du désir » (p. 167, sic !) ?
Pour conclure, on trouve d’un côté ce triste constat qui est posé en quatrième de couverture : « désaffection », « inutilité » du christianisme ? ; « crise que traverse l’Église » ; « recul des fidèles comme des vocations ». De l’autre, les solutions que prétend apporter Louis-Marie Chauvet ne semblent pas à la hauteur des graves difficultés actuelles, ses démonstrations ne sont pas toujours convaincantes et ses points de vue semblent bien entachés justement de préjugés et de concessions que tout Chrétien n’est pas obligé de partager. Loin de simplifier pour le lecteur une doctrine chrétienne jugée trop « complexe », le message « de grand écart » et de « décapage » qu’il veut nous faire passer est rempli d’affirmations discutables et de contradictions, notamment historiques. Ce n’est pas une pensée conceptuelle humaine, aussi brillante et subtile soit-elle, qui va nous sauver, la sienne ou une autre... Bien que « se plaçant dans le sillage du pape François », il n’est pas sûr que ce dernier partage ce détachement prôné, alors même qu’il utilise la religion à toutes les sauces et souvent pour des utilités et des intérêts qui lui sont étrangers.
Jean-Marc Boudier
[1] Il y a consacré, par ailleurs, un ouvrage : Du symbolique au symbole. Essai sur les sacrements. (Paris, Les Éditions du Cerf, coll. « Rites et symboles », 1979).